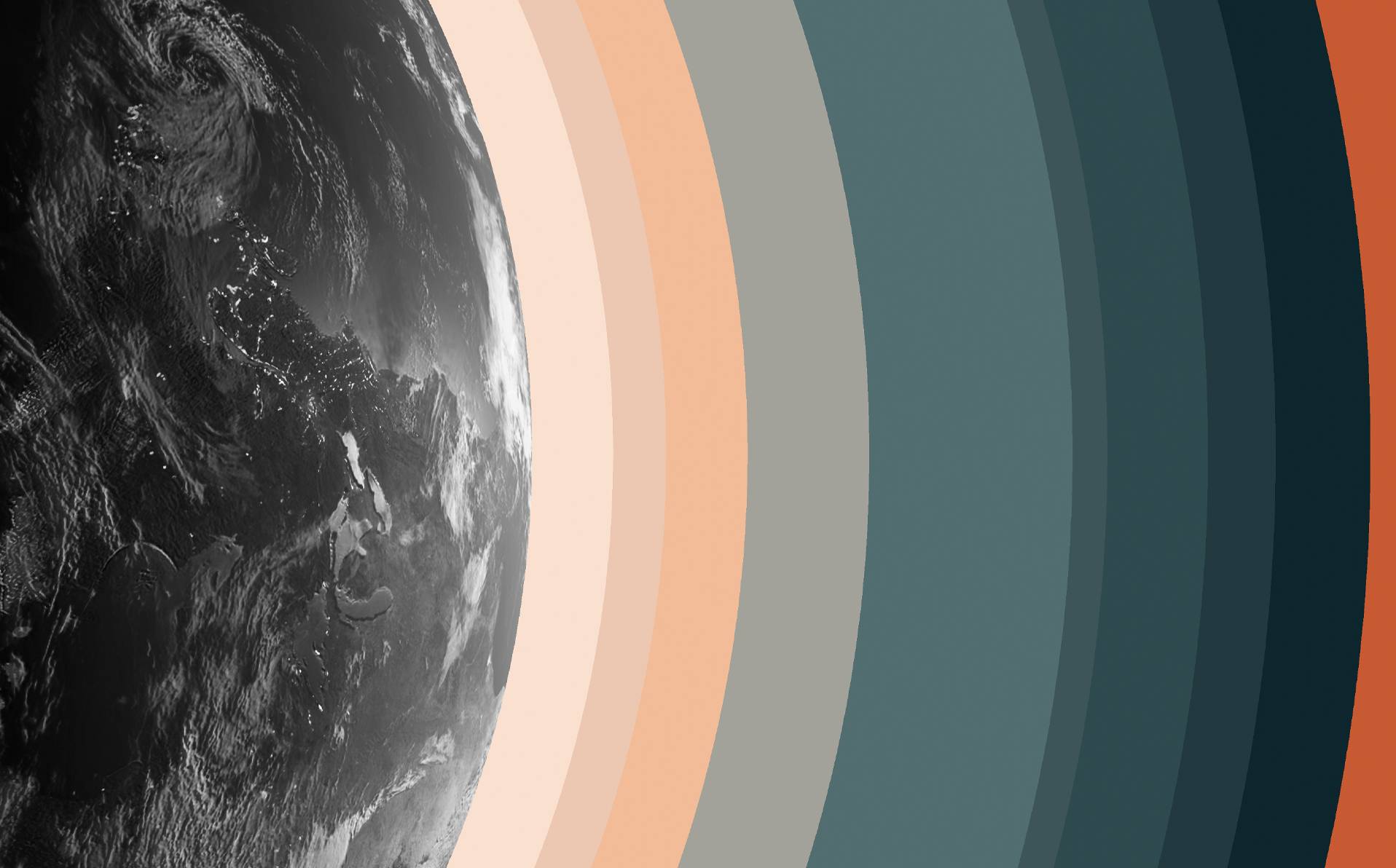 @SHUTTERSTOCK
@SHUTTERSTOCK
À la frontière de l’espace
Où s’arrête l’atmosphère et où commence l’espace ? La question n’est pas si scolaire. Elle est même stratégique, à l’heure où ballons espions et missiles hypersoniques s’y installent. Enquête dans la zone floue.
Où diable l’espace commence-t-il ? La question peut paraître un peu gratuite ; elle est pourtant au cœur d’enjeux militaires de plus en plus tendus. “D’un point de vue juridique, il n’y a aucune définition claire de la limite basse au niveau international”, tranche d’emblée Clémence Lambrecht, experte en droit spatial au CNES, l’agence spatiale française. Vraiment ?
Quid alors de la barre des 100 km, cette ligne dite de Karman, souvent citée comme la frontière officielle entre l’air et l’espace ? “Elle n’est pas reconnue comme telle et n’a donc aucune force du point de vue du droit international”, poursuit la juriste. De fait, aussi absurde que cela puisse paraître soixante-dix ans après les débuts de la conquête spatiale, personne ne sait vraiment à quel endroit, à quelle distance de la Terre commence l’immensité cosmique.
Jurisprudence Spoutnik
Il faut dire que cette lacune n’a pour l’instant gêné personne, n’entravant ni l’essor du secteur aérien ni l’exploration spatiale. Sauf que cette région jusqu’ici assez peu fréquentée, au-dessus de l’enveloppe de vol des avions de ligne (20 km), et en dessous de celle où les satellites orbitent régulièrement (vers 160-200 km), fait ces dernières années l’objet d’un intérêt croissant. C’est dans ces contrées extrêmes, entre 80 et 110 km, que se font catapulter depuis 2021 les premiers touristes de l’espace.
Là, surtout, que les militaires font de plus en plus souvent évoluer leurs discrets ballons espions, comme l’a fait éclater au grand jour, début 2023, l’affaire des ballons chinois. Et là encore, qu’ils déploient depuis peu leurs missiles hypervéloces, comme ceux qui viennent d’être utilisés en Ukraine et en Israël. “Ce milieu, jusqu’ici peu exploité, le devient de plus en plus”, confirme l’officier général Alexis Rougier, nommé en août dernier en charge de la très haute altitude au sein de l’armée française de l’air et de l’espace – un poste nouvellement créé.
Chacun peut survoler ce qu’il veut. C’est le sésame sur lequel s’est bâtie toute la conquête spatiale
Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique
Or cette zone de très haute altitude reste un grand vide juridique. Alors même qu’elle est encadrée par deux autres zones, elles, bien réglementées : en dessous, l’espace aérien, régi par la convention de Chicago de 1944, est considéré comme souverain, ce qui signifie qu’aucun aéronef ne peut s’y aventurer sans en avoir reçu l’autorisation des autorités dont il dépend. Au-dessus, l’espace, le vrai, reconnu par le traité de 1967 comme un bien commun dont l’accès est totalement libre, sans possibilité d’appropriation ni de revendication territoriale.
La fin du no man’s sky
“C’est Spoutnik, le premier satellite mis en orbite en 1957, qui a fait jurisprudence, décode Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS. À l’époque, les Américains n’étaient pas ravis qu’un objet russe passe régulièrement au-dessus de leur tête, mais vu l’enthousiasme général, ils n’ont pas eu d’autre choix que de saluer publiquement l’exploit. Ce qui a de facto ouvert la voie à une reconnaissance implicite que l’espace n’est pas souverain : chacun peut survoler ce qu’il veut. C’est le sésame sur lequel s’est bâtie toute la conquête spatiale, sans que le besoin de définir où l’espace commence ne se fasse sentir jusqu’ici.”
Sauf qu’entre l’espace aérien et l’espace tout court, il y a ces hautes altitudes, longtemps peu fréquentées, qui ne sont plus le no man’s sky qu’elles étaient il y a encore cinq ans. Ici, le tourisme n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les fusées et les navettes, de plus en plus souvent réutilisables, y font des allers-retours incessants. Après avoir étendu leurs opérations sur terre, sur mer, dans l’air et dans l’espace, les militaires lorgnent désormais sur cette région et ne se contentent plus d’y envoyer quelques avions espions.
La délimitation de l’espace est à l’ordre du jour du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique depuis 1967!
Clémence Lambrecht, experte en droit spatial au CNES, l’agence spatiale française
C’est tout un arsenal qui s’y précipite : des ballons et des dirigeables plus légers que l’air et plus ou moins manœuvrables – on les appelle aussi des pseudo-satellites, ce qui ne manque pas d’ajouter encore à la confusion – ; des avions solaires, comme le Zephyr d’Airbus, qui peut rester plus de trois semaines en vol ; des missiles balistiques (jusqu’à 30 km) et des planeurs hypersoniques (jusqu’à 70 km, et plus), à qui l’altitude offre de multiples avantages, comme le résume le général Rougier : “La très haute altitude présente trois gains militaires essentiels : l’allonge [le rayon d’action], la permanence – pour les plateformes à haute altitude – et la survivabilité, due à l’altitude ou à la vitesse. Ce qui explique que cette région fasse l’objet d’un intérêt croissant, comme l’ont démontré le ballon chinois abattu et les missiles hypervéloces déployés récemment par Israël.”
Il y a un hic
“C’est un milieu dont l’accès est moins onéreux que l’espace, peu contrôlé, et qui peut offrir des capacités intéressantes en matière de surveillance ou de résilience des infrastructures de communication, abonde Xavier Pasco de la FRS. C’est clairement un espace à fort potentiel, amené à se développer.” De quoi redynamiser les débats menés depuis les tout débuts de l’ère spatiale dans l’organe des Nations unies qui traite de la question, sans succès jusqu’ici. “La question de la délimitation de l’espace est à l’ordre du jour du sous-comité juridique du Copuos, le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, depuis 1967. Il se réunit une fois par an, mais n’est toujours pas parvenu à un consensus”, souligne Clémence Lambrecht. Ni sur une altitude limite, ni même à vrai dire sur le critère qui permettrait de la déterminer : l’endroit où l’air de l’atmosphère laisse la place au vide ? La hauteur à laquelle la rotondité de la Terre commence à être perceptible ? L’endroit où l’apesanteur se fait sentir ? L’altitude maximale de survie pour un être humain ?
Toutes ces pistes, et bien d’autres – leur amplitude s’étire de 30 km à 1,5 million de kilomètres –, ont pourtant été longuement discutées, et certaines le sont encore dans ce cénacle. Mais elles achoppent sur un premier écueil : l’absence de consensus scientifique. La complexité de la question rejaillit d’ailleurs au sein même de la définition de l’espace : “Milieu extraterrestre”, synthétise le dictionnaire Le Robert. “Milieu situé au-delà de l’atmosphère terrestre et dans lequel évoluent les corps célestes”, précise le Larousse. Autrement dit, et jusqu’ici tout le monde est à peu près d’accord, l’espace commence là où l’atmosphère s’arrête.
99,99997 %
Le hic, c’est que l’atmosphère monte haut. Très haut. Selon le découpage scientifique officiel issu d’un consensus international, la thermosphère culmine déjà à plus de 600 km d’altitude. Et l’exosphère jusqu’à plusieurs milliers de kilomètres. On pourrait donc s’attendre à ce que l’espace commence au-delà. Sauf que cette région est déjà clairement spatiale, puisqu’elle englobe une partie de l’orbite basse, où l’on peut croiser des mégaconstellations de satellites – le réseau Starlink s’étire entre 350 et 600 km –, ou la Station spatiale internationale, en orbite autour de 400 km. Autrement dit, la définition même de l’espace est un non-sens, puisque dans les faits, atmosphère et espace se chevauchent en partie.
Toutes ces définitions sont raisonnables : tout dépend de l’objectif poursuivi
Scott Neumann, président de la commission des records astronautiques
D’ailleurs, sorti des manuels, bien malin qui sait en pratique où l’atmosphère terrestre s’arrête réellement. “C’est difficile à dire, car il y a une certaine continuité : la densité de l’atmosphère décroît certes rapidement, de façon exponentielle avec l’altitude, mais de façon continue”, explique Philippe Keckhut, directeur de l’Académie spatiale d’Ile-de-France, ex-directeur du Latmos, le Laboratoire atmosphères, observations spatiales. Même si 99,99997 % de la masse de l’atmosphère terrestre se trouve en dessous de la barre des 100 km, il en subsiste des traces résiduelles au-delà, jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres d’altitude, dans ce que nous considérons sans ambiguïté comme l’espace. Négligeable ? Pas sûr : même perchée à 400 km, la Station spatiale internationale doit régulièrement être repositionnée sur son orbite pour compenser le freinage – et donc la perte d’altitude – dû à ce reliquat d’atomes.
Le test de l’avion
“Si on prend le cas de l’hydrogène, des mesures récentes montrent qu’il faut s’éloigner de trois fois la distance Terre-Lune pour que sa concentration diminue au point d’atteindre la teneur observée dans l’espace interplanétaire”, reprend le spécialiste de la haute atmosphère. “Les limites des couches atmosphériques sont définies en fonction des variations des profils de température ou de la composition des gaz, mais il n’y a pas de ligne de séparation physique nette entre l’atmosphère et l’espace”, résume Petr Pisoft, du département de physique de l’atmosphère de la Charles University de Prague.
L’un des premiers à avoir tenté d’apporter une réponse à la question, à l’aube de la conquête spatiale, dans les années 1950, essayait de trouver la parade avec une approche plus pragmatique. Ingénieur en aéronautique hongro-américain, Theodore von Karman a postulé que l’espace devait commencer à l’endroit où les ailes d’avion n’ont plus assez d’air pour assurer une portance suffisante. Après tout, pourquoi pas ? Il a donc imaginé un aéronef théorique qui parviendrait à accélérer indéfiniment pour contrer la baisse progressive de densité de l’air et s’élever. Ce qui, en pratique, est impossible, puisqu’un moteur à réaction ne peut plus fonctionner correctement lorsque la pression devient trop basse – le record d’altitude de 37,65 km a été atteint par un MiG-25 russe en 1977. Mais peu importe : en se basant sur ce cas d’école purement théorique, Karman avait conclu que moyennant une vitesse vertigineuse, cet appareil pouvait espérer voler jusqu’à l’altitude maximale de 100 km, donnant naissance à la ligne imaginaire qui porte son nom.
Un des risques, c’est d’être démuni si un État décide d’abattre un véhicule aérospatial à ces altitudes intermédiaires
Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
Une valeur qui a rapidement été reconnue comme la limite de l’espace par la FAI, la Fédération internationale de l’aéronautique, chargée d’homologuer les records du vol le plus long, le plus haut, etc. “Avec le développement du spatial, la FAI a dû mettre en place en 1960 une seconde catégorie pour distinguer les records aéronautiques des records aérospatiaux. Elle a choisi de retenir la proposition de Karman”, explique Nicolas Bérend, expert technique de la commission des records au sein de l’institution.
La limite des 80 km
Pourtant, cette limite des 100 km n’a pas fait beaucoup d’émules. Seule une poignée de pays, dont le Canada, le Danemark et l’Australie, l’ont adoptée comme frontière officielle de l’espace. D’ailleurs, la NASA, qui l’utilisait autrefois comme jalon pour décerner ses prestigieuses ailes d’astronaute, a changé son fusil d’épaule en 2005 pour s’aligner sur la limite des 80 km – plus exactement des 50 miles, soit 80,4672 km –, reconnue par l’US Air Force “sur le principe qu’un aéronef n’est plus manœuvrable aérodynamiquement au-delà de cette altitude”, détaille Nicolas Bérend. Sans pour autant que cela signifie que les États-Unis reconnaissent cette délimitation comme officielle. Il s’agissait surtout d’homogénéiser les pratiques afin de mettre fin à une incongruité : des pilotes volant dans le même appareil n’étaient pas tous considérés comme astronautes, selon qu’ils appartenaient au corps de l’US Air Force ou de la NASA… Une question honorifique, donc.
Plusieurs voix se sont tout de même élevées ces dernières années pour faire valoir que s’il fallait choisir une limite, c’est la ligne des 80 km qu’il faudrait adopter.
Kepler contre Newton
La première, plutôt anecdotique, émane de l’entreprise américaine Virgin Galactic. Avant même d’envoyer ses premiers passagers en l’air en 2021, la pionnière du tourisme suborbital a frappé à la porte de la FAI en lui suggérant d’imiter la NASA et de considérer que l’espace commence à 80 km. Les raisons sont plus mercantiles que scientifiques : à cause de choix techniques, ses vols ne dépassent que péniblement les 80 km, ce qui ne permet pas à la FAI de les homologuer. “C’est évidemment un argument commercial de poids de pouvoir assurer à ses passagers qu’ils sont officiellement reconnus comme des astronautes”, sourit Nicolas Bérend. Surtout quand son concurrent direct, Blue Origin, parvient, lui, à passer le cap des 100 km.
Leur opération de lobbying a coïncidé avec des arguments plus scientifiques cette fois, avancés depuis 2018 par Jonathan McDowell, un astrophysicien du très sérieux Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Et ce, avec une approche complémentaire et symétrique à celle de Karman, visant à définir la plus basse altitude à laquelle un satellite parviendrait à tourner autour de la Terre sans retomber, en partant du postulat que si un satellite est en orbite, c’est bien qu’il est dans l’espace. Alors que Karman poussait les lois de Newton dans leurs retranchements, McDowell propose de mettre celles de Kepler à l’épreuve. Pourquoi pas.
Il n’y a pas côté français de volonté de définir une limite géographique à l’espace : nous préférons rester dans une forme d’ambiguïté constructive
Général Alexis Rougier, en charge de la très haute altitude au sein de l’armée française de l’air et de l’espace
Calculs à l’appui, McDowell avance que l’on peut descendre encore plus bas que l’orbite la plus basse jamais empruntée à ce jour par un satellite, le chinois Lixing-1 catapulté en 2016 à 124 km d’altitude. Et sort de sa poche un cas particulier : un satellite positionné sur une orbite non pas circulaire, comme le Lixing-1, mais elliptique pourrait périodiquement descendre à des altitudes encore plus basses, jusqu’à 80-90 km, avant de remonter pour dépasser les 100 km, et ainsi de suite. “Si on considère les 100 km comme la limite de l’espace extra-atmosphérique, cela signifie que ce satellite passerait son temps à entrer et sortir de l’espace, note le chercheur. Ce qui conduit obligatoirement, pour éviter cette configuration gênante, à conclure que l’espace débute dès 80 km.” CQFD.
Nœud du problème
Certes, il ne pourrait pas rester bien longtemps à cette altitude, un ou deux jours au mieux, ce qui rend l’exemple aussi peu réaliste que celui de Karman, mais McDowell s’appuie sur un autre argument : même si l’atmosphère n’a pas de limite précise, elle présente tout de même une discontinuité vers les 80 km qui pourrait, selon lui, faire office de frontière. “C’est à cet endroit, entre la mésosphère et la thermosphère, que l’on enregistre les températures les plus basses de l’atmosphère, qui descendent largement sous les - 100 °C, avant de remonter dans la thermosphère”, confirme Alain Hauchecorne, chercheur émérite spécialiste de ces régions, et président de la section scientifique de l’Académie de l’air et de l’espace.
Des arguments que la FAI a étudiés de près pendant plusieurs années, en intégrant de nombreux paramètres (les variations de la densité de l’atmosphère au cours des cycles solaires, les coefficients de portance théoriques des satellites de différentes tailles, allant des CubeSats à la Station spatiale internationale, l’analyse elliptique périgée-apogée des durées de vie orbitales réelles des satellites, etc.) avant de confirmer, en avril 2024, sa préférence pour les 100 km. “Nous avons étudié la question en détailet la commission des records astronautiques a unanimement décidé de conserver l’approche de Karman, qui lui a semblé la plus pertinente dans ce contexte, explique Nicolas Bérend, qui était en charge des calculs. Même si les arguments de McDowell sont tout à fait recevables techniquement.” “Beaucoup d’approches peuvent aboutir à une valeur inférieure à 100 km, ajoute Scott Neumann, président de cette commission. Et toutes ces définitions sont raisonnables : tout dépend de l’objectif poursuivi.”
Tout juste 18 km
C’est justement le nœud du problème. Car les enjeux de la délimitation de l’espace ne se cantonnent pas à savoir si des pilotes ou quelques touristes fortunés méritent ou non un diplôme d’astronaute pour avoir flotté quelques minutes en apesanteur. Avec ses travaux, Jonathan McDowell espère surtout combler le vide juridique de la très haute altitude qui, selon lui, est de moins en moins tenable.
“Je pense qu’un des risques de ne pas s’entendre sur une frontière, c’est d’être démuni si un État décide un jour d’abattre un véhicule aérospatial étranger au-dessus de son territoire à ces altitudes intermédiaires”, prévient-il. Un cas qui a déjà failli se présenter, les États-Unis ayant abattu le ballon chinois alors que celui-ci était tout juste redescendu à 18 km, dans leur espace aérien contrôlé. Que ce serait-il passé s’ils l’avaient attaqué à 22 km ? Et qui serait responsable si un aéronef venait à s’écraser ou à être abattu ? “Si un véhicule évoluant à très haute altitude causait un dommage au sol, il y aurait un doute : il faudrait décider au cas par cas du régime applicable, le droit aérien, ou le droit spatial”, analyse Clémence Lambrecht.
Un non-choix
Le général Rougier, qui a précisément pour mission de définir la feuille de route de la doctrine de la France dans ces hautes sphères , le reconnaît sans ambages : “Il n’y a pour l’instant pas de volonté côté français de définir une limite géographique à l’espace : nous préférons rester dans une forme d’ambiguïté constructive”, reprenant une célèbre expression de l’Américain Henry Kissinger pour désigner l’utilisation délibérée d’un langage ambigu sur une question sensible, afin d’en tirer un avantage politique. “Si on fixe une limite, cela donne des clés de compréhension à notre compétiteur, qui peut alors tenter de la contourner ou de la défier”, précise l’ex-chef d’état-major du Commandement de l’espace. Et on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment…
À la vérité, la France n’est pas la seule dans ce cas : elle fait partie d’un club de pays réunissant les principales puissances spatiales, dont les États-Unis et la Chine, qui adoptent dans les réunions feutrées du Copuos une approche dite fonctionnaliste. “L’idée est de ne pas statuer sur un objet en fonction de son altitude, mais plutôt en fonction de l’objectif de l’activité : est-il destiné à envoyer un objet dans l’espace extra-atmosphérique ou pas ?”, décrypte Clémence Lambrecht. Un choix du non-choix que la France a réitéré en avril 2024 devant le sous-comité juridique du Copuos, selon les archives que nous avons pu consulter. Lesquelles font aussi état de pays, sans préciser lesquels, partisans au contraire qu’une limite soit fixée autour des 110 km – une approche dite spatialiste. Ou d’autres encore, qui proposent de définir non pas une limite, mais une zone transitoire, entre 50 et 100 km, une sorte de protoespace qui bénéficierait d’un statut propre, au même titre que l’espace aérien par exemple.
“Cette instance, où chaque pays présente ses arguments et donne son avis, fonctionne sur le consensus, note Clémence Lambrecht. Cela peut nécessiter beaucoup de discussions, c’est vrai, mais c’est ce qui fait la force du droit spatial.” “Une limite n’a de valeur que si elle est partagée”, résume le général Rougier. L’espace, on avait déjà du mal à savoir où il finit… On n’est visiblement pas près de savoir où il commence.












