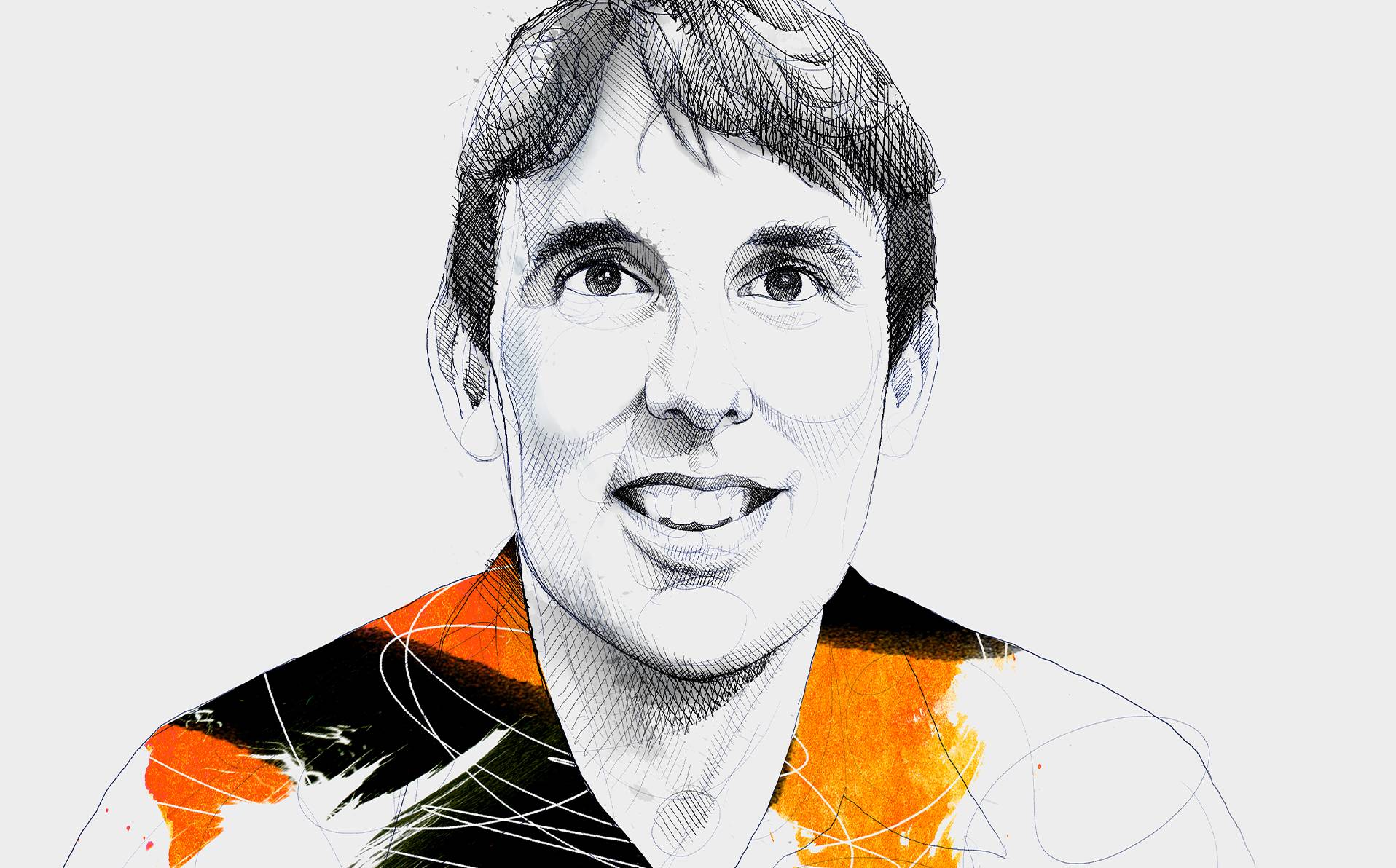 @DAVID DESPAU/COLAGENE.COM
@DAVID DESPAU/COLAGENE.COM
"Nous n’avons pas besoin du langage pour penser"
Linguistes, philosophes, psychologues s’entendent sur la question : le langage est nécessaire, selon eux, à l’élaboration de toute forme de pensée. Pourtant, pour le professeur de psycholinguistique Edward Gibson, il est grand temps de dissocier les deux.
Epsiloon : Cette idée vous vient-elle de travaux en neurologie, de l’observation du cerveau ?
Edward Gibson : En effet, elle part d’un constat que nous avons fait en réalisant de nombreuses expériences : même si cela peut paraître étonnant, le langage et la pensée sont dissociés dans notre cerveau. Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, nous avons pu comparer l’activation des régions cérébrales en fonction de nos tâches : la lecture ou l’écoute d’un ensemble de phrases écrites ou de sons qui ne font pas sens, et d’autres tâches liées à la pensée, comme la mémoire spatiale, l’arithmétique, la musique, le raisonnement social, et même la compréhension de programmes informatiques… Et ce que nous trouvons, le fait fascinant, c’est que les régions du réseau linguistique ne s’activent que pour le langage de haut niveau, lorsque les mots se combinent pour former des phrases. Toutes les autres tâches s’effectuent en dehors de ce réseau. Rien à voir donc avec le langage…
Epsiloon : Des travaux montrent pourtant que le langage et certains processus cognitifs sont traités dans des zones qui se chevauchent…
Edward Gibson : Sauf que c’est faux. Cette impression de chevauchement survient quand on fait la moyenne des cerveaux étudiés. Ce n’est pas ce qui se passe au niveau individuel : si la topographie de nos fonctions neurologiques est largement similaire, elle présente aussi des spécificités. Il n’y a pas deux réseaux linguistiques identiques d’une personne à l’autre. C’est ce qui crée de la confusion.
Epsiloon : Vous vous appuyez aussi sur des cas cliniques…
Edward Gibson : Oui, sur de nombreux cas de personnes présentant de graves déficiences linguistiques, qui affectent à la fois les capacités lexicales et syntaxiques. Elles ne peuvent ni parler ni écrire, ni comprendre une langue. Mais elles sont aussi performantes que les témoins de leur âge dans toutes les tâches qui n’impliquent pas le langage, comme résoudre un problème mathématique ; effectuer une planification exécutive et suivre des instructions non verbales ; s’engager dans diverses formes de raisonnements, y compris scientifique, logique formel ou causal sur le monde ; s’orienter dans le monde ; porter des jugements sémantiques… Les preuves sont sans équivoque. À l’inverse, un système linguistique intact n’impliquera pas nécessairement des capacités de raisonnement intactes. Des personnes atteintes de troubles génétiques caractérisés par des degrés variables de déficience intellectuelle, comme les syndromes de Down ou de Williams, présentent des capacités linguistiques proches de la normale. Tout cela montre que nous n’avons pas besoin du langage pour nous engager dans une pensée complexe, et que nous n’avons pas besoin d’une pensée complexe pour maîtriser le langage…
Epsiloon : Mais comment expliquer que le manque d’accès au langage puisse avoir des effets néfastes sur la cognition des enfants ?
Edward Gibson : S’il y a des effets, ils sont relativement subtils. Certains enfants sourds, nés de parents entendants, qui n’ont parfois pas reçu de langue des signes pendant des années, apprennent malgré tout à penser de manière sophistiquée – même si des retards peuvent être rapportés en matière de raisonnement social. Le langage joue indéniablement un rôle social et d’apprentissage, car c’est un outil de communication. C’est même sa fonction première. Au point que de nombreuses caractéristiques des langues semblent être optimisées pour permettre un transfert d’information efficace. Le langage est un système qui nous aide à encoder nos pensées en séquences de mots, et à déduire des significations à partir de séquences de mots produites par d’autres. Mais cela ne veut pas dire qu’il nous fait penser. C’est plutôt une interface entre la perception et la pensée.
Epsiloon : Nous avons pourtant souvent l’impression que les mots, même intérieurs, structurent nos pensées…
Edward Gibson : Parce que cela se produit réellement ! De nombreuses personnes ont l’impression de “penser” en utilisant le langage. C’est une sensation compréhensible : il se peut que nous pensions dans les autres réseaux et que nous convertissions ensuite ces pensées en langage, par réflexe la plupart du temps.
Epsiloon : Évidemment, quand on dissocie la pensée du langage, on pense aux animaux…
Edward Gibson : Absolument. Leurs systèmes de communication sont différents, peut-être plus rudimentaires, mais des travaux sur la cognition animale ont déjà établi que de nombreuses espèces ont un mode de pensée très sophistiqué. Cette exploration du fonctionnement de la pensée chez d’autres animaux que l’humain, et en quoi elle est similaire ou différente, est un terrain de recherche vertigineux.












