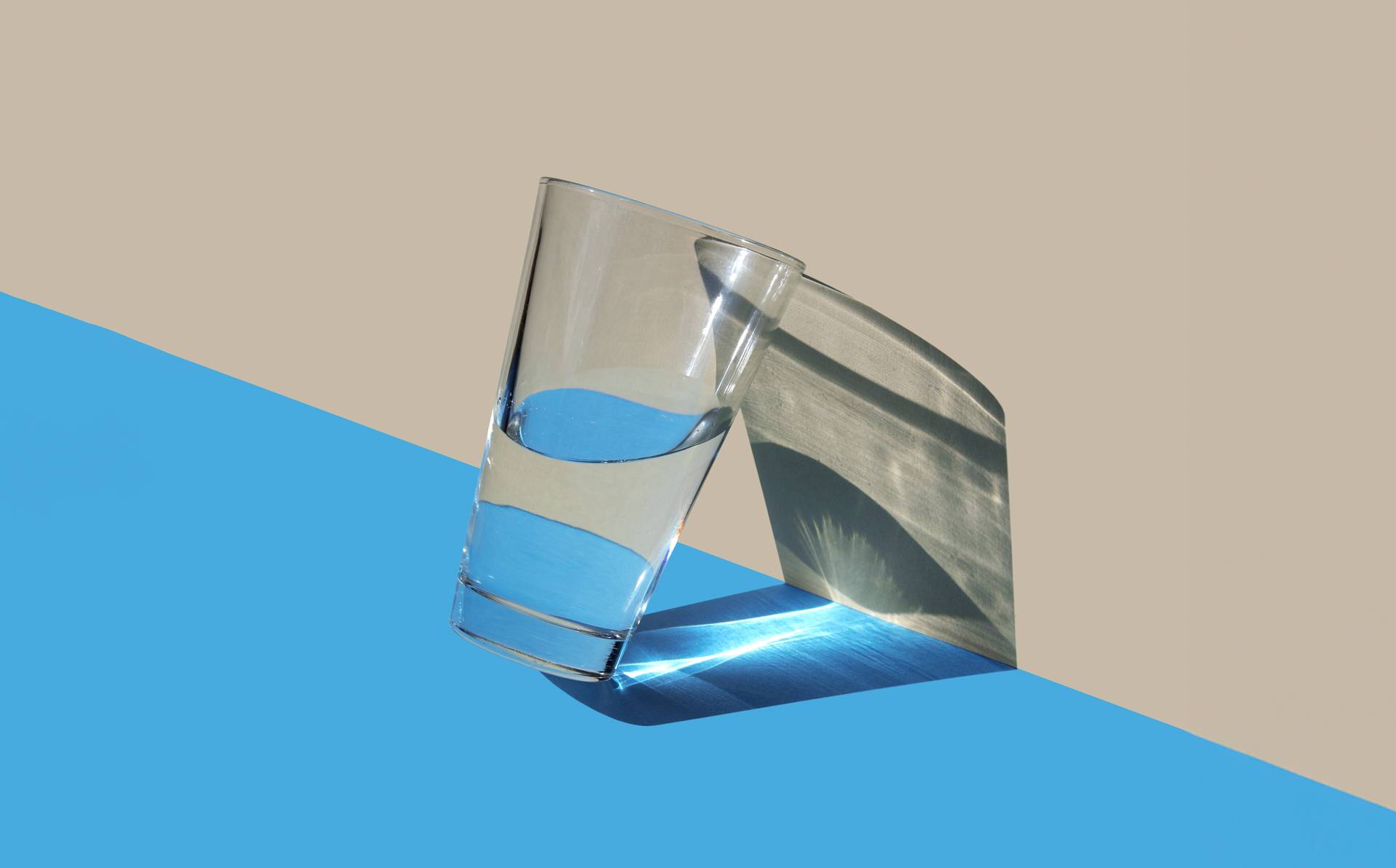 @GETTY IMAGES
@GETTY IMAGES
Analyse d’un verre d’eau : faut-il avoir peur du robinet ?
C’est l’aliment le plus contrôlé. Et pourtant, les restrictions temporaires se multiplient. On trouve de plus en plus de composés chimiques, herbicides, PFAS, nanoparticules… dans l’eau du robinet. Nous avons demandé aux meilleurs experts ce qu’il faut penser de la qualité de l'eau qui arrive dans notre cuisine.
Elle est perçue comme une valeur sûre : sa consommation est en hausse continue depuis 2018, au détriment de l’eau en bouteille, car 83 % des Français la jugent bien contrôlée. Plus des deux tiers d’entre eux en boivent même quotidiennement. Les récentes affaires qui ont touché les eaux minérales, polluées par des microplastiques et soumises à des traitements non autorisés, risquent fort de faire grimper encore la cote de popularité du robinet. Peut-on pour autant lui accorder une confiance totale ?
“L’eau du robinet reste, et de loin, l’aliment le plus contrôlé de France”, pose d’emblée Philippe Hartemann, professeur honoraire à l’université de Lorraine, ancien membre du Haut Conseil de la santé publique. Et c’est vrai, avant d’arriver dans votre verre, cette eau subit des batteries de traitements (filtration, décantation, désinfection au chlore…) visant à la rendre potable. Des analyses sont ensuite régulièrement effectuées par les ARS, les agences régionales de santé, avec quelque 325 000 prélèvements en France en 2022, selon les chiffres disponibles, depuis la sortie des stations de potabilisation jusqu’au robinet, pour vérifier que sa qualité reste dans les standards souhaités. Une procédure effectivement plutôt rassurante sur le principe.
Non conforme
Sauf que ces contrôles révèlent que l’eau n’a pas toujours la qualité attendue. Si plus de 98 % de la population a reçu en 2022 une eau du robinet respectant en permanence les critères requis concernant les microbes et les nitrates, ce taux chute à 84,6 % pour les pesticides. Si bien que près de 818 000 Français ont été alimentés au moins une fois par une eau non conforme, “ayant pu conduire à une restriction temporaire de son usage”, précise l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Rien d’étonnant dans la mesure où des composés toxiques, ou supposés tels, sont de plus en plus souvent détectés dans les nappes phréatiques, les torrents, les lacs, les rivières dont provient l’eau du robinet. Une étude menée en 2021 par des chercheurs allemands de l’université de Landau a ainsi démontré qu’en quinze ans, les fréquences de détection ont augmenté pour toutes les familles : les herbicides (+ 5,4 %), les plastifiants (+ 9,2 %), les solvants (+ 9,3 %), les fongicides (+ 2,3 %), les retardateurs de flamme (+ 2,2 %)… En un mot, la qualité des eaux de surface qui alimentent le robinet est en net recul, probablement à cause d’une explosion des composés chimiques à usage industriel.
Nous avons identifié des molécules pour la première fois simplement parce qu’elles n’ont jamais été cherchées avant
Hans Peter Arp, professeur à l’université norvégienne des sciences et technologies
Ce n’est pas tout. D’autres études démontrent que ces eaux contiennent de plus en plus de composés chimiques problématiques… qui ne sont ni traités ni surveillés. La réglementation prévoit en effet le suivi d’une soixantaine de paramètres bactériologiques, physico-chimiques et radiologiques dûment listés dans un arrêté. Or, en 2019, une équipe de scientifiques a révélé, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas, la présence dans les eaux de surface de persistent and mobile chemicals, les PMOC, des composés chimiques industriels – dont font partie les PFAS –, qui ne font l’objet d’aucun traitement ni suivi.
Ni suivis ni traités
Sur les 57 PMOC qu’elle a ciblés, l’équipe en a trouvé 43 dans ses échantillons, dont 23 qui n’avaient jamais été détectés. “Nous avons identifié des molécules pour la première fois simplement parce qu’elles n’avaient jamais été recherchées auparavant”, lâche Hans Peter Arp, professeur à l’université norvégienne des sciences et technologies, qui précise que “des recherches similaires sont en cours au niveau du robinet.” Et selon lui, il n’y a aucune raison que la situation soit meilleure en France.
Ce que semble confirmer une enquête menée par la cellule investigation de Radio France : des échantillons d’eau du robinet prélevés dans toute la France entre la mi-avril et début juin 2024 contenaient pour 43 % d’entre eux des PFAS, qui ne sont ni suivis ni traités. Et même, pour 27 d’entre eux, des PFAS interdits ou classés comme cancérogènes, dont cinq à des niveaux préoccupants.
De plus en plus d’inconnues
Certes, une mise à jour de la liste des composés à surveiller est prévue pour 2026, avec l’ajout d’une vingtaine de PFAS, et d’autres polluants à la toxicité avérée ou suspectée. Sauf que l’effort semble tardif et insuffisant : les chercheurs estiment le nombre de PFAS à près de 12 000. “Nous connaissons relativement bien la toxicité de trois ou quatre d’entre eux, mais il y a des milliers d’autres composés. Même si tous ne sont pas à surveiller, il serait souhaitable d’élargir les listes des molécules suivies”, estime Pierre Labadie, directeur de recherche dans l’équipe de physico et toxicochimie de l’environnement au CNRS. Pour de nombreux chercheurs, une vingtaine de PFAS ça ne suffit pas.
Il faut réaliser un vrai travail d’investigation, beaucoup de produits sont protégés par le secret industriel
Pierre Labadie, directeur de recherche dans l’équipe de physico et toxicochimie de l’environnement au CNRS
Les PFAS ne sont pas les seules substances qui interrogent. “Certains métabolites de pesticides, comme l’acide trifluoroacétique, ou TFA, ne sont pas surveillés en France, alors qu’ils le sont en Allemagne, et que leur concentration ne fait qu’augmenter”, pointe Hans Peter Arp. Les métabolites sont de petites molécules issues de la dégradation des composés chimiques industriels, qui complexifient le tableau, comme le souligne Pauline Cervan, toxicologue et chargée de mission au sein de l’ONG Générations futures : “Les métabolites de pesticides sont plus solubles dans l’eau et ils persistent plus longtemps dans l’environnement que les pesticides eux-mêmes. L’atrazine, par exemple, a été interdite en 2003, mais ses métabolites restent présents dans l’eau potable. Pourtant très peu de métabolites sont contrôlés.” Sans compter un autre niveau d’incertitude : les interactions entre ces molécules peuvent les rendre plus dangereuses qu’elles ne le sont individuellement, prévient Nathalie Karpel, chercheuse en chimie des milieux et des matériaux à l’université de Poitiers : “Il y a un risque d’effet cocktail. Le mélange de composés chimiques peut augmenter ou, à l’inverse, diminuer la toxicité de certains polluants.”
Cadence effrénée
Le problème, c’est que l’explosion des usages industriels est telle que les chercheurs ne savent pas toujours quoi chercher pour alerter les autorités sanitaires. “Nous sommes incapables de repérer tous les PFAS d’un échantillon et nous ne savons même pas toujours quels composés chercher, confesse Pierre Labadie. Il faut parfois réaliser un vrai travail d’investigation, en sachant que beaucoup de produits sont protégés par le secret industriel.” De fait, les techniques d’analyse n’ont pas suivi la cadence effrénée des dépôts de brevets de molécules imposée par la créativité débordante des industriels. “Pour un nombre élevé de PFAS, nous ne disposons pas toujours en laboratoire des composés nécessaires pour effectuer des analyses quantitatives”, poursuit le chercheur.
Tout ce qui est à l’échelle nanométrique pénètre plus facilement dans les cellules, avec des effets possibles sur la santé
Mathieu Pédrot, enseignant-chercheur en géosciences à l’université de Rennes
L’un des exemples les plus révélateurs est celui des nanoparticules. “Les résolutions de nos outils ne permettent pas d’aller au-delà des 20 micromètres, alors que beaucoup de microplastiques ont une taille inférieure, jusqu’au nanomètre, expose Mathieu Pédrot, enseignant-chercheur en géosciences à l’université de Rennes. Tout ce qui est à l’échelle nanométrique pénètre plus facilement dans les cellules, avec des effets possibles sur la santé.” Qui plus est, les seuils limites sont généralement définis sans faire de différence entre un complexe organique, un ion, une nanoparticule…. “Or cette spéciation physique et chimique joue un rôle clé dans la toxicité”, précise le chercheur.
De plus en plus cher
Des limites scientifiques et techniques qui trahissent aussi des enjeux financiers. Les collectivités locales, responsables de la qualité de l’eau du robinet, ont vu leurs dotations rognées de plus de 30 % au cours des dix dernières années. Elles doivent pourtant prendre en charge près de 17 000 unités de potabilisation d’eau, dont une grande partie en zones rurales, un réseau très étendu qui demande d’importants coûts d’entretien. Ces zones peu peuplées sont précisément celles qui sont les moins fréquemment contrôlés : un réseau de distribution alimentant une commune de 2 000 habitants n’est assujetti qu’à une moyenne de 10 prélèvements par an au niveau du robinet, contre 812 pour les villes de plus 625 000 habitants, comme Marseille ou Paris.
Et avec l’allongement de la liste des polluants, traiter et assurer la qualité sanitaire de l’eau va coûter de plus en plus cher. “De nombreux PFAS pourraient être éliminés avec des procédés utilisés dans les usines de traitement, comme la filtration sur charbon actif. Néanmoins, l’élimination des PFAS les plus mobiles nécessite la mise en œuvre de procédés coûteux et énergivores”, illustre Pierre Labadie.
À la source
Mais le nœud du problème reste l’étude de la toxicité de ces composés chimiques. Car certains seuils sont arbitraires, davantage fondés sur les capacités techniques de détection que sur la dangerosité réelle, comme le confirme l’ARS Paca : “Les seuils pour les pesticides ne sont pas fondés sur une approche toxicologique et n’ont donc pas de signification sanitaire. Leur objectif est simplement de réduire leur présence au plus bas niveau de concentration possible.”
Et même quand la science dispose d’assez de connaissances pour édicter des limites, celles-ci ne sont pas toujours suivies, regrette Pauline Cervan : “La valeur sanitaire limite fixée par l’Anses pour le PFOA, l’acide perfluorooctanoïque, dans l’eau potable est de 0,075 µg/l. Or, la limite réglementaire retenue est de 0,1 µg/l… pour la somme de 20 PFAS, incluant le PFOA. Elle est donc potentiellement moins sévère !”
Le cas du du chlorothalonil R471811
Le mieux serait encore de réduire ces pollutions à la source, estime Hans Peter Arp : “Nous ne pouvons pas reporter tous nos problèmes sur le traitement de l’eau. Nous devons mettre en place des mesures contraignantes en taxant les industriels et en les poursuivant judiciairement s’il le faut. C’est un enjeu de santé publique.” Certaines entreprises se sont déjà engagées dans la bataille réglementaire, selon Générations futures. L’ONG a récemment dénoncé le lobbying du chimiste Syngenta auprès de l’Anses, qui aurait abouti en mai 2024 à un rehaussement du seuil limite d’un métabolite du chlorothalonil R471811, un fongicide interdit depuis 2019, pourtant considéré comme cancérogène probable en 2022. “La concentration maximale tolérée pour juger l’eau ‘conforme’ est relevée de près de 10 fois : elle passe de 0,1 µg/l à 0,9 µg/l”, s’insurge l’association. L’Agence nous assure de son côté qu’elle ne s’est pas uniquement appuyée sur l’argumentaire du fabricant pour revoir sa copie : “L’Anses a bien reçu de la part de la société Syngenta des données importantes pour documenter les travaux menés par ses experts. Mais elle a également examiné les données bibliographiques disponibles”, détaille une porte-parole. Reste que nos voisins suisses, eux, ont conservé le seuil initial de 0,1 µg/l.
Des pathologies en hausse
Des études sont toujours en cours pour savoir si la consommation régulière d’eau du robinet présente des risques pour la santé. Mais comment isoler cette pratique des autres facteurs environnementaux (pollution de l’air, alimentation…) soupçonnés de jouer un rôle dans la montée en puissance récente de certaines pathologies, comme les cancers et la puberté précoce ? Pour certaines molécules présentes dans l’eau, le verdict est clair : les nanoparticules, les résidus de médicaments ou des composés considérés comme des perturbateurs endocriniens ont bien des effets sur la santé humaine. Sans que ces risques aient pu jusqu’ici être directement reliés au robinet.












