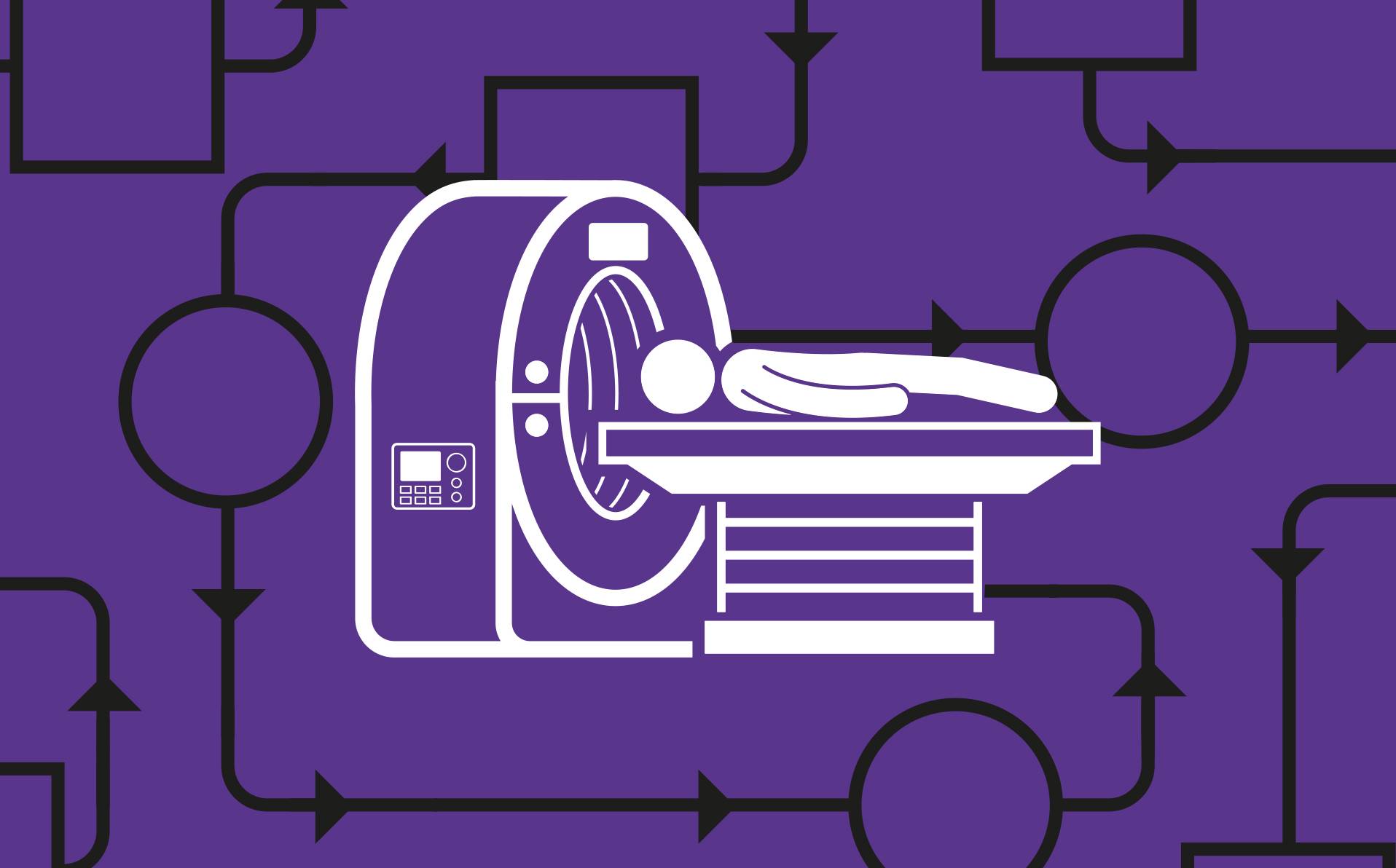 @SHUTTERSTOCK
@SHUTTERSTOCK
Le casse-tête de l’imagerie médicale
Utilisée pour le suivi des grossesses, la détection des tumeurs, la confirmation d’un diagnostic ou le dépistage, l’imagerie médicale est devenue incontournable. Sauf que cette technologie est coûteuse et présente aussi des risques… Pas si simple de se faire une idée. Un casse-tête que nous avons schématisé en un labyrinthe de faits et de chiffres à partir des dernières études.
Un recours massif et forte progression
43 % de la population française a bénéficié d’au moins un acte d’imagerie de diagnostic en 2022.
+11 % de scanners et +22 % d’IRM entre 2017 et 2022. Tandis que les actes de radiologie reculent de 19 %.
Des rendez-vous difficiles à obtenir : il faut en moyenne 32 jours pour avoir une IRM : 12 jours de plus que le délai maximal prévu par le plan cancer 2014-2019. Avec de fortes variations régionales.
Sachant que le coût peut décourager : seul 70 % est remboursé par la Sécurité sociale si l’acte est prescrit par le médecin traitant, le reste est à charge.
Un manque de machines ?
En 2022, l’Hexagone a deux fois moins d’IRM par habitant que les États-Unis. Et pourtant, les Français sont plus nombreux à y recourir : 143 actes contre 108 pour 1 000 habitants.
Et ce sont des équipements coûteux : 1 million d’euros pour un appareil IRM, 600 000 € pour un scanner, 150 000 € pour une mammographie…
Sans compter leur impact carbone. 13,7 kg de CO2 par examen pour une IRM, contre 2,1 kg pour un scanner et encore 650 g pour une échographie.
4 % de la consommation d’énergie d’un hôpital est liée à l’imagerie médicale.
300 millions d’euros : C’est le montant des économies envisagées par l’Assurance maladie sur les actes d’imagerie médicale, d’ici deux ans.












